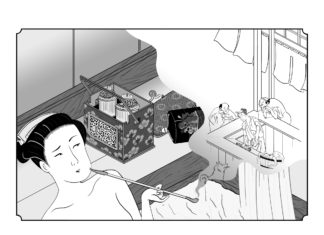Ronsard, Rutebeuf, Verlaine, Chédid, Baudelaire, Césaire, Collobert, Prévert… les poètes français ou francophones ont parcouru les siècles laissant par ci par là quelques vers immémoriaux. Nos pensées et nos sensibilités se sont même enrichies par la poésie.
Le genre se transforme, s’enrichit à travers les dialectes, les argots, les mots et sonorités étrangères. Pourtant, de nos jours, la poésie est bien souvent mise à l’écart voire oubliée par le grand public. Tout le monde connaît ses classiques mais connaissons-nous vraiment ce qui sonne à notre époque ?
Entretien avec Béatrice Bonhomme, poète, professeure à l’Université Côte d’Azur et fondatrice de la revue Nu(e)
.
.
.
.
La lecture et l’écriture font intégralement partie de votre vie. Y’a-t-il une certaine magie qui se produit ?
.
.
.
.
Oui, bien sûr, il y a une magie qui se produit dans l’acte de lecture, accompagnée de désir et de bonheur. La première expérience, a été, pour moi, celle de l’apprentissage de la lecture qui n’a pas eu lieu à l’école mais en pleine nature. Ma mère m’a appris à lire dans la colline niçoise, Elle m’asseyait sur ses genoux et elle me tendait le livre de lecture. De ce premier mot, qu’un jour je suis parvenue à déchiffrer, sont nées la magie, la possession, l’impression d’avoir à soi le monde entier. Ce mot et de lui la puissance de saisir. C’était comme si j’avais possédé cette matinée éclatante de soleil. A cet âge, je ne faisais pas de différence entre les éléments et les mots, le mot « soleil » brille sur la page, le mot « bleu » comprend la mer et le ciel.

Enfant, je lisais aussi bien le Club des 5 dont j’aimais le personnage de « Claude », que Les 4 filles du Docteur March. Dans le livre de Louisa May Alcott, il y a « Joséphine » qui se fait appeler « Jo » et qui rêve de devenir écrivaine. Beaucoup de jeunes lectrices ont pu s’identifier à elle. Ayant 4 frères, j’avais l’impression moi-même d’être un garçon et d’être plus libre grâce à « Jo ». L’enfance vous permet de vous projeter fortement dans les personnages que vous découvrez dans les livres. J’aimais les romancières anglo-saxonnes, mais j’ai bientôt découvert les romanciers français du XIX et du XXème siècles, les voyageurs de l’imaginaire, Jules Verne, le théâtre, Marivaux par exemple, que j’ai lu avec passion durant mon adolescence. La poésie, La Fontaine (qui est resté un de mes auteurs préférés), des poèmes de Rimbaud, des poètes surréalistes. J’étais également sensible à la poésie des contes. La passion pour la langue française existe depuis ce moment, depuis toujours, donc. J’enseigne la littérature et la poésie du XX et du XXIème siècles. Chaque fois que j’approche un texte littéraire, un poème, j’éprouve la même sensation de merveille et j’ai envie de transmettre cet éblouissement comme si, pour moi, les mots étaient vivants. Après cet apprentissage très physique et concret de la lecture, très tôt dans ma vie, j’ai eu envie d’écrire le mieux possible. L’écriture, c’est mon être au monde, ma façon d’exister dans le monde et d’être moi-même en rapport, en lien, en échange, en relation avec les autres.
.
.
.
.
La poésie nécessite-t-elle pour l’auteur un savoir-faire à acquérir selon vous ?
.
.
.
.
Si l’on revient au sens étymologique de poésie, poiein, on retrouve le sens de faire : « poésie, art de faire » et il y a bien sûr un travail sur la langue, un travail formel, factuel, prosodique, métrique, musical. La poésie, c’est aussi un travail artisanal comme celui du peintre avec sa palette de peinture. Il y faut un savoir-faire comme celui du musicien. Mais la poésie, comme l’art, se situe au-delà d’un savoir-faire. C’est l’expression d’une émotion, d’un être-au-monde, une traduction du monde sensible, qui, d’après moi, se relie à l’archétype, à la pensée mythique ou magique : le Carmen. L’émotion poétique est un mouvement qui part du plus intime, du plus circonstanciel, pour se projeter dans le monde et les mots et devenir communicable. La poésie permet ainsi de créer du lien entre intime et communauté par le partage. Afin d’entendre la poésie, il faut essayer de l’écouter, la ressentir, la partager. Elle est reliée au non-conceptuel, le concept étant « volatilisé » par la force du souffle qu’expriment le mot et sa connotation prélogique. Elle est reliée au cosmos. Si l’on peut ainsi le dire, la poésie est l’entre-langue des hommes les moins touchés par le concept et elle prête sa voix aux règnes non-humains, végétaux, animaux, êtres inorganiques.
.
.
.
.

.
.
.
La poésie doit donc constituer un son ?
.
.
.
.
La poésie possède un lien au musical, à la rythmique, à la scansion : comptines, phrases incantatoires, formulettes, contes, histoires, fables, épopées, élégies. La poésie est une pulsation, une musique, une chorégraphie qui est fondée sur le geste, le geste d’écrire, répétition pulsionnelle, litanie presque rituelle. Alors, les mots, la poésie, m’accompagnent depuis toujours, depuis la petite enfance, avec des sortes de phrases scandées : “le soleil est à toi, le soleil est à toi” “papillon, papillon, bats-les, les soldats de la prairie”. Le poète est aussi un musicien.
.
.
.
.
Le slam est-il une continuation de la poésie ou un art à part ?
.
.
.
.
Le slam a un aspect populaire pertinent au même titre que les chansons et les comptines. Tous ces genres représentent une forme de poésie au quotidien. La poésie est liée aux archétypes. Au même titre que les fables et les contes, elle fait partie d’un inconscient collectif. La poésie ne peut être détachée de l’oralité, car la voix permet de transmettre et de mémoriser. La métrique, la prosodie, la rime avaient aussi cette fonction. Poésie qui avait vocation, autrefois, d’être orale, chantée, récitée, dite. Pour moi, le rapport à la poésie est pictural, il y a un lien aux images mais aussi à la musique et comme je travaille avec des peintres pour des livres d’artiste, je travaille aussi souvent avec des musiciens pour des récitals.
.
.
.
.
Alors beaucoup de poésies classiques sont connues, la poésie contemporaine est peu reconnue. Pourquoi un tel désamour ?
.
.
.
.
Il me semble que la poésie s’est un peu séparée en France du grand public au moment du post-surréalisme. Paul Eluard, Louis Aragon lisaient encore devant un très un large public. Dans une autre aire géographique, on peut citer le poète palestinien Mahmoud Darwich qui lisait devant de grandes foules.

De nos jours, peut-on vraiment parler aujourd’hui de désamour pour la poésie contemporaine ? Il y a encore de grands évènements autour de la poésie contemporaine, entre autres, le Printemps des poètes ou encore le Marché de la poésie. On peut aussi citer quelques poètes très populaires, dans le sens où leurs livres sont vendus en tous lieux, comme Christian Bobin. On peut aussi évoquer Hélène Dorion et Jean-Pierre Siméon qui sont lus par un public nombreux et jeune, et ils accomplissent ainsi une œuvre de transmission. J’aimerais aussi, quant à moi, à côté des recherches très intéressantes réalisées en poésie, mettre en lumière une poésie démocratique, populaire et partageable. C’est ce que j’essaie de construire avec mes étudiants qui partagent leurs créations dans des lectures chorales. Il m’arrive de faire des lectures devant un public ouvert, notamment dans le Berry. Celles et ceux qui viennent écouter ne sont pas forcément des personnes qui lisent volontiers de la poésie et pourtant ils se retrouvent dans les textes.
.
.
.
.
Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Samuel Beckett, Maurice Maeterlinck… La poésie a également séduit la francophonie. Est-ce un genre qui naturellement dépasse les frontières ?
.
.
.
.
La poésie, bien entendu, comme les genres archétypaux, traverse toutes les frontières et rend compte d’une existence « inséparée », poreuse, entre homme et monde, mots et choses, morts et vivants, règnes minéraux, végétaux, animaux, humains, frontières géographiques, politiques, ou linguistiques. La francophonie est très vivante en poésie comme nous le font comprendre chaque jour de grands poètes francophones de différentes origines, origine libanaise avec Salah Stétié et Vénus Khoury-Ghata, origine québécoise avec Hélène Dorion, tunisienne avec Abelwahab Meddeb, Tahar Bekri et tant d’autres…
.
.
.
.
Une poésie traduite perd-elle de son intensité ?
.
.
.
.
La traduction de la poésie est complexe. Elle est souvent réalisée par des poètes. Pierre Jean Jouve ne connaissait pas toujours bien la langue originale des poètes qu’il traduisait et c’était Blanche Reverchon, son épouse, qui parfois l’aidait en effectuant un mot à mot préalable dans une traduction d’abord littérale. Ensuite, il transposait dans sa langue de poète. La poésie ne perd pas de son intensité en étant traduite, elle retrouve une autre intensité. C’est une œuvre autre et à part entière. Le texte devient un autre texte, même lorsqu’il est très fidèle à l’original, avec sa propre intensité.
.
.
.
.
La poésie peut-elle également consister en une évasion ?
.
.
.
.
La poésie, ou plus généralement l’art, est, en tout cas, une forme de résistance. Jean Giono, a été emprisonné deux fois. D’abord en tant que pacifiste au début de la Seconde Guerre mondiale. Puis, à la fin, en tant que suspect de collaboration avec l’Allemagne. Il a été, depuis, lavé de tout soupçon. Dans sa cellule, alors qu’il avait peur d’être exécuté, il a contemplé les taches qui couvraient les murs de sa prison et à partir de ces cartographies aléatoires, il s’est inventé un monde fait de voyages imaginaires. De là sont nées des œuvres littéraires : les Chroniques et le Cycle du Hussard.
.
.
.
.

.
.
.
Malgré les longues études et analyses, Jean Giono est-il un auteur qui vous surprend encore ?
.
.
.
.
Giono me surprend notamment par l’actualité de ses textes. Il a déjà tout dit de l’apocalypse climatique (Batailles dans la Montagne, Noé, Colline etc), de l’atrocité des guerres et des massacres en masse (Le Grand Troupeau). Il est écologiste avant la lettre, il prône les vraies richesses manuelles comme intellectuelles, son œuvre est « écopoéthique » dans son intégralité. Par ailleurs, c’est un magicien de la langue, un amoureux de la nature, un poète en prose qui chante « le chant du monde » et de l’univers, le dieu Pan, le lien de l’homme aux autres règnes, végétaux, animaux. Il ne sépare pas l’homme du monde. Il n’y a pas de hiérarchie entre les êtres du monde, pas de mainmise ou de domination de l’homme sur l’univers. L’être à part entière, c’est l’arbre, ce « hêtre » magique, vrai personnage du Roi sans divertissement.
.
.
.
.
Quel est votre vers préféré ?
.
.
.
.
Je citerai un poème, celui de Robert Desnos : « Demain » :
Âgé de cent mille ans, j’aurais encore la force
De t’attendre, ô demain pressenti par l’espoir.
Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses,
Peut gémir : neuf est le matin, neuf est le soir.
Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille,
Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu,
Nous parlons à voix basse et nous tendons l’oreille
À maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu.
Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore
De la splendeur du jour et de tous ses présents.
Si nous ne dormons pas c’est pour guetter l’aurore
Qui prouvera qu’enfin nous vivons au présent.
.
.
.
.

.
.
.
Photo de couverture : ©A.MACARRI-Univ-Côte d’Azur