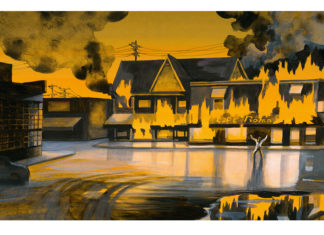A peine la liste de nos questions sortie, Léon Landini, 93 ans, lance : « Avant toute chose, savez-vous ce qu’est la guérilla urbaine ? ».
Voici commence ce passionnant échange qui retrace de terribles événements vieux de plus de 75 ans. Léon Landini est un des tout derniers FTP-MOI (Francs-Tireurs et Partisans – Main d’œuvre Etrangère). Ces unités communistes de la Résistance armée ont, à partir d’avril 1942, conduit la guérilla dans les grandes villes de France sous l’occupation. Lyon en est le plus bel exemple. Cette « capitale gauloise », selon le général De Gaulle, devint « la capitale de la Résistance française ».
.
.
Avec une émotion certaine, M. Landini est ici le porte-parole de ceux et de celles qui ont pris les armes contre l’injustice et qui sont tombés sous les coups et les balles de l’occupant nazi. Entretien.
.
.
La guérilla urbaine n’est pas vraiment connue. J’ai pratiqué la Résistance en famille. J’ai participé à 16 ans et demi à mon premier déraillement entre Saint-Raphaël et Cannes. En décembre 1940, mon frère a fait dérailler 8 wagons de marchandise à la gare de triage Fréjus-Plage. Il a fait tomber une roue du wagon. Pour cela il fallait la grue pour la remettre en place. Elle était amenée de Carnoul, ancienne mairie communiste, à 30 kilomètres. La grue a mis 3 jours pour venir.
Les premiers italiens qui ont été tués entre Marseille et Vintimille l’ont été à Saint-Raphaël. Avec mon ami Jean Carrara, à peine plus âgé que moi, j’ai allumé les mèches des bombes qui ont tué les premiers italiens. Suite à cela, les carabiniers sont venus chez Jeannot qui n’était pas là puis ils sont allés à mon domicile où Jean était présent alors que moi j’étais absent. Ma mère a demandé à Jean de s’enfuir par le jardin. Il a ensuite rejoint les FTP-MOI. Quant à moi, je suis parti dans la Creuse chez l’oncle de ma belle-sœur, le père Legros. On me disait que là-bas le maquis n’attendait plus que moi pour faire la Libération. Mon ami Jean a été tué dans les environs de Dignes le 28 mars 1944. Les Allemands l’avaient laissé agonir pendant des heures interdisant la population de venir l’emporter. Il est mort dans la nuit à l’hôpital.
J’avais à peine 17 ans. J’ai d’abord été ouvrier agricole et au bout de six mois, j’ai fait connaissance avec les maquisards du coin et j’ai participé à trois déraillements. Dans chaque village, les paysans nous accueillaient sans aucun problème. Mais j’ai appris que mon frère, Roger, et mon père avaient été arrêtés par les Italiens et qu’ils avaient tortu rés. Ils ont fait avaler un litre de pétrole puis un kilo de sel à mon frère. Mais comme il ne parlait pas, ces bourreaux l’ont posé un casque sur la tête qui lui explosé tout le cuir chevelu. Mon frère a été six heures dans le coma puis a simulé la folie pendant près de 8 mois. Il faisait ses besoins sur lui ; les Italiens lui nettoyaient le cul. Mon père n’a pas non plus parlé. Les deux ont été amenés à la prison nouvelle de Nice. Dans une salle, les hommes couchaient sur des paillasses par terre. Il y avait notamment le professeur Renan. Celui-ci était persuadé que mon frère était devenu vraiment fou. Mon père savait que c’était de la simulation. Suite à l’armistice de 1943 signé par le maréchal italien Badoglio, les gardes italiens sont partis mais n’ont pas ouvert les cellules, laissant les prisonniers aux nouveaux occupants, les Allemands. Voulant s’organiser pour s’évader, mon frère a arrêté de simuler la folie et le professeur Renan s’est écrié : « C’est un miracle ! ». Mon frère l’a tout de suite rassuré et lui a proposé de refaire ses études pour distinguer la simulation de la folie (rires).
rés. Ils ont fait avaler un litre de pétrole puis un kilo de sel à mon frère. Mais comme il ne parlait pas, ces bourreaux l’ont posé un casque sur la tête qui lui explosé tout le cuir chevelu. Mon frère a été six heures dans le coma puis a simulé la folie pendant près de 8 mois. Il faisait ses besoins sur lui ; les Italiens lui nettoyaient le cul. Mon père n’a pas non plus parlé. Les deux ont été amenés à la prison nouvelle de Nice. Dans une salle, les hommes couchaient sur des paillasses par terre. Il y avait notamment le professeur Renan. Celui-ci était persuadé que mon frère était devenu vraiment fou. Mon père savait que c’était de la simulation. Suite à l’armistice de 1943 signé par le maréchal italien Badoglio, les gardes italiens sont partis mais n’ont pas ouvert les cellules, laissant les prisonniers aux nouveaux occupants, les Allemands. Voulant s’organiser pour s’évader, mon frère a arrêté de simuler la folie et le professeur Renan s’est écrié : « C’est un miracle ! ». Mon frère l’a tout de suite rassuré et lui a proposé de refaire ses études pour distinguer la simulation de la folie (rires).
Sur la route de la déportation, mon père et mon frère ont pu s’échapper à Dijon et ont pu rejoindre clandestinement la Creuse. Les radios suisses nous avaient pourtant informés que tous les deux avaient été fusillés. Lorsqu’ils m’ont rejoint, je les ai présentés au responsable du maquis, Jean-Baptiste Virvialle. Ce dernier a présenté mon frère à l’état-major résistant de Limoges. En tant qu’Italien, Roger a eu pour mission de partir rejoindre les FTP-MOI à Lyon. Mon frère avait déjà 30 ans, marié, deux enfants et il a demandé s’il n’y avait pas de choix. Il n’avait pas vu sa famille depuis plus de 8 mois. N’ayant pas le choix, Roger est allé à Lyon. Quelques temps après, il m’a écrit que je puisse le rejoindre. A la gare de Perrache, mon frère m’a accueilli avec le responsable politique du groupe FTP-MOI Carmagnole-Liberté. On m’a prévenu que la vie n’était pas la même qu’au maquis. Les opérations militaires se passaient tous les jours et l’espérance de vie n’était que de trois mois. Au bout d’un mois d’opérations, on devenait un vétéran… Mais mon frère avait toute confiance en moi. J’avais déjà fait mes preuves dans le passé.
La guérilla urbaine n’a rien à voir avec tout ce qui peut se faire ailleurs. J’étais dans un groupe  qui a provoqué trois déraillements sur trois voies différentes le même jour à Lyon. Nous étions en opération tous les jours. Des directives avaient été envoyées par Charles Tillon. C’était un petit livre. Les 5 responsables de Camargnole-Liberté étaient 5 juifs dont 3 étaient des anciens des Brigades internationales. Notre formation venait en marchant. Pour courir, il faut savoir marcher.
qui a provoqué trois déraillements sur trois voies différentes le même jour à Lyon. Nous étions en opération tous les jours. Des directives avaient été envoyées par Charles Tillon. C’était un petit livre. Les 5 responsables de Camargnole-Liberté étaient 5 juifs dont 3 étaient des anciens des Brigades internationales. Notre formation venait en marchant. Pour courir, il faut savoir marcher.
Fin mars-début avril 1944 à Lyon, le responsable FFI nommé par le général De Gaulle, le colonel Descour, a donné l’ordre à tous les mouvements de résistance de quitter Lyon en prévision d’un débarquement. Les Allemands auraient pu bloquer la ville. Tous ont quitté Lyon à l’exception des FPTF (Francs-tireurs Partisans Français) et des FTP MOI (Francs-tireurs Partisans Main d’Œuvre Étrangère). Mais pour les FTPF, il y a eu une trahison : la plupart des responsables de la zone Sud a été fusillée. Du 15 mai 1944 à la Libération de Lyon, il n’y avait donc que les FTP MOI. Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, a témoigné du fait qu’il n’a vu la résistance armée à Lyon que durant les mois qui ont précédé la Libération. Cette résistance armée c’était les FTP MOI. Mon frère, Roger, s’est insurgé contre l’idée de quitter Lyon. Nous avions des camarades toujours prisonniers et nous pouvions laisser les Allemands tranquilles, les laisser abattre n’importe qui. Nous ne sommes pas partis.
Le 6 juin 1944, le jour du débarquement, mon frère a craint que si nous étions capturés, les autres mouvements de résistance auraient ricaner. Donc, nous sommes partis au maquis. Mon frère avait donné comme directives : « Nous n’allons ni dans les fermes, ni dans les maisons. Nous faisons des baraques avec des branches en forêt. Et tous les 15 jours, nous devions bouger 10 kilomètres plus loin. Le 8 juin, l’agent de liaison Monique a réussi à nous retrouver et nous a prévenus que rien ne se passait à Lyon. Tout était normal. Nous avons donc décidé de faire redescendre nos deux groupes les plus expérimentés (8 personnes par groupe) afin de continuer les opérations contre les Allemands. J’étais adjoint d’un des responsables de ces groupes. Mon frère est resté dans le maquis avec les plus âgés d’entre nous.
Le soir même, nous étions de retour à Lyon. Le 9 juin, le premier allemand abattu dans la rue (à Villeurbanne) après le débarquement c’est moi qui l’ai abattu d’une rafale de mitraillette. C’était un aviateur de la Luftwaffe. Il nettoyait son pantalon plein de poussière en attendant le tramway. J’étais avec une camarade, Simone, qui était derrière moi. Elle a ensuite vidé son chargeur sur l’Allemand au sol et lui a pris le revolver du cadavre. Ces moments, on ne peut les oublier. J’ai eu une occasion de tuer un autre allemand. Lorsque je lui ai coupé la route, il n’a pas compris. Il s’est aperçu que j’avais un revolver à la main. Son visage s’est décompose et cela vous ne pouvez pas l’oubliez. J’ai tiré deux-trois fois. Il n’y a pas eu de flaques de sang. On voit comme un petit trou de cigarette. L’Allemand a titubé et mon camarade lui a tiré une balle dans la tête puis a récupéré son arme. On entendait parler des parachutages d’armes mais on ne les voyait pas. Les autres mouvements refusaient de donner des armes à Carmagnole-Liberté. Les premières attaques ont été faites avec des revolvers en bois huilés qui étaient pointés dans le dos des flics français. Le but était de dérober de vraies armes.
Le 13 juin, nous étions à ce moment-là 8 : 4 de protection, 4 d’attaque (je faisais partie de ces derniers). Nous avons attaqué un convoi de parachutistes allemands qui partait pour l’entraînement à Bron au parachutage. Le premier camion arrivé, j’ai donné l’ordre de lancer des grenades. Les corps passaient par-dessus les ridelles du véhicule. La presse a déclaré que 10 allemands avaient été tués lors de l’attaque. Elle minimisait toujours. Il y a dû y avoir une trentaine de morts et de blessés graves. Mais la tension était forte. Avant d’être arrêté, je voyais des Allemands dans les rues le revolver à la main par peur d’être attaqués.
Voici quelques exemples de la guérilla urbaine. Au maquis, il était possible de fraterniser avec les autres camarades. À Lyon, nous avions chacun notre chambre et nous ne pouvions pas se contacter. Les directives données étaient de prendre toujours un tramway entre deux stations et à la dernière porte ; de ne jamais descendre à un arrêt, de descendre à toute vitesse entre deux arrêts. Si quelqu’un vous regarde avec un peu d’insistance, vous sautez du tramway tout de suite. Nous faisions nos opérations à visage découvert. À Bron-Avia, nous avons attaqué une usine. Nous avons enfermé les 300 ouvriers- Ils ont vu nos visages.
Un jour, j’étais dans le tramway avec un copain. Je lui ai fait remarquer qu’une jolie blondinette ne faisait que de me regarder. Je croyais que je lui plaisais. Mon ami me prend par le bras et nous quittons le tramway. Il m’explique alors que la fille ne me regardait pas mais lui. Car lors de l’attaque du garage Rachet, nous avions enfermé les personnes présentes dans une pièce et lui les gardait. Moi avec d’autres camarades, nous mettions des bombes à l’intérieur des véhicules allemands.
La blondinette était la fille du directeur (rires).
52 de mes camarades FTP MOI ont été arrêtés et sont morts sous la torture. Pas un seul n’a parlé. Certains étaient inconnus ; nous n’avons jamais trouvé le corps de certains. Il n’y a jamais eu d’arrestations suite à l’interrogatoire d’un prisonnier. Lyon est la ville de France où la guérilla urbaine a accompli le plus grand nombre d’opérations militaires. À cause du sabotage intensif des voies ferrées et des usines produisant pour l’occupant, Lyon, deuxième centre industriel du pays, n’a été bombardé qu’une seule fois, alors que d’autres villes l’ont été à de multiples reprises.
En conclusion, je dirais qu’après la Libération, près d’1/3 de mes camarades sont morts de crises cardiaques entre l’âge de 40 ans et 60 ans. La tension a été trop immense pendant la guerre.
Tous ceux qui peu ou prou ont fait un acte de résistance mérite hommage et respect. Distribuer des tracts un soir pouvait vous amener à être fusillé. Mais entre distribuer des tracts une nuit et distribuer des tracts dix fois c’est différent. Le dernier avait risqué sa vie dix fois. Et entre distribuer des tracts en se cachant et abattre en plein jour un Allemand en pleine ville et à visage découvert : ce n’est pas encore le même geste.
Et si la France a pu être présente lors de la capitulation sans condition allemande du 8 mai 1945, c’est en partie grâce à l’action armée de la Résistance. La Résistance était un arbre qui donnait des fruits. Les fruits c’était la résistance armée. On a opposé la résistance armée et la résistance politique. Toute attaque était politique (!). Des journaux comme Combat ou encore Libération ont été créés à l’origine par la presse clandestine. S’il n’y avait pas eu d’arbre, il n’y aurait pas eu de résistance armée. Mais s’il n’y avait pas eu de résistance armée, à quoi aurait servi l’arbre ? Tout était lié.
.
.

.
.
.
Peut-on dire que vous avez connu une jeunesse politisée ? (Son père Aristodème, originaire du village de Torniella en Toscane, Italie)
Oui. Mon père avait déjà eu trois fois des problèmes avec des fascistes armés de fusils. Il a donc dû quitter l’Italie laissant son épouse et ses enfants sous la garde de ses parents. Mon père a choisi le pays des droits de l’Homme et la Révolution : la France. Après avoir passé la frontière, il a été en Meurthe-et-Moselle et a travaillé dans une mine de fer où il a retrouvé des amis italiens. Avec les Français, il y avait des tensions. Mon père est allé voir le siège local du Parti communiste. Les Français avaient l’habitude de boiser pour ne pas que le plafond s’écroule sur eux alors que les italiens ne le faisaient mal. Lorsque les Français demandaient des augmentations, la direction répondait que les Italiens n’en demandaient jamais. Il était donc difficile de faire grève avec 40% d’Italiens. Mon père a voulu régler cela et a fait en sorte que les Italiens fassent grève. Tout le monde a alors été augmenté. Le parti communiste l’a tout de même prévenu qu’avec toutes ces histoires, la police française cherchait à le renvoyer dans son pays. Mon père est donc parti dans le Var pour travailler dans la forêt comme bucheron. Il a tout de même continué à militer.
J’ai le souvenir que mon père m’emmenait aux manifestations communistes et sur ses épaules, le poing levé, je chantais l’Internationale. La foule m’applaudissait. Dans ma jeunesse, Marcel Cachin ou Jacques Duclos venaient manger à la maison. Certains qui venaient étaient des fugitifs fuyant leur pays d’origine. Nous avons hébergé en 1937 Palmiro Togliatti, un des fondateurs du Parti communiste italien. A 17 ans, mon frère avait déjà organisé une grève dans son usine et organisait la venue des Italiens souhaitant s’engager dans les brigades internationales durant la Guerre d’Espagne.
Depuis l’enfance, j’ai appris à résister.
.

.
.
.
L’entrée en résistance a-t-elle été pour vous une évidence pour votre famille ? ou vous vous êtes interrogé ?
Le 11 novembre 1940, mon frère avait organisé une distribution de tracts à Saint Raphaël. Le lendemain, les soldats italiens sont arrivés pour occuper la zone. Avec Jean Carrara, je les ai vus arrivés sur la route. Ils allaient à Toulon. Je leur alors dit que la marine française massacrait tous les Italiens qui s’approchent. En une heure, tous les motards s’étaient garés sur le bord de la route fouillant leur moteur (rires). Ils ne voulaient pas aller à Toulon.
Le soir même, à table, mon père a dit : « Notre page de la résistance (distribution de tracts, graffiti de faucille et de marteau et croix de Lorraine) vient de se tourner. J’ai fui l’Italie poursuivi par les Fascistes. Je n’ai pas été très bien accueilli en France mais j’ai tout de même pu vivre ici. J’ai pu avoir à nouveau des enfants, je les ai nourris. Nous ne pouvons accepter que les Fascistes se baladent victorieux dans Saint-Raphaël. Nous devons tuer les Italiens ». Ma mère a alors réagi : elle avait des neveux dans l’armée de Mussolini. Mon père a répondu que si leurs chefs leur demandent de tirer sur les civils, ils allaient tirer. S’ils ne veulent pas être tués, ils n’ont qu’à déserter comme je l’avais fait en 1915. Mon père avait été condamné à 20 ans de prison et finalement avait été amnistié à la fin de la Première Guerre mondiale.
.
.
.
Après être sorti de prison, votre frère Roger a fait dérailler 8 wagons de marchandise dans la gare de triage de Fréjus-Plage en décembre 1940. Ce qui est probablement un des tout premiers déraillements effectués par la Résistance française. Les communistes n’ont pas attendu l’invasion de l’URSS pour être résistants.
Même sans directives, les communistes ont réagi en fonction de leur sentiment comme republier le journal « L’Humanité ». Dès 1940, il y a des opérations communistes partout en France. Mon frère a essayé de relancer des camarades mais peu l’ont suivi. Il a surtout regroupé des jeunes qui avaient l’esprit communiste. Nous avions mis des explosifs dans une bouteille de gaz à l’Hôtel Sirilli qui n’a pas explosé. 195 chemises noires étaient en train de déjeuner. La bombe devait exploser après le couvre-feu pour ne pas tuer des civils français.
.
.
.
Le 12 octobre 1942, vous participez au sabotage de la voie ferrée qui relie Saint-Raphaël à Cannes, provoquant le déraillement d’un train de marchandises allemand. Comment a-t-il été organisé ?
.
.
.
Nous ne recrutions pas n’importe qui. Nous connaissions ceux qui nous rejoignaient. Lorsque j’ai voulu rejoindre Jean-Baptiste Virvialle, le responsable du maquis de la Creuse, il ne me connaissait pas assez et donc n’avait pas confiance. J’ai alors expliqué que mon père et mon frère étaient emprisonnés et torturés. Virvialle m’a finalement accepté. À Lyon, le recrutement était encore plus dur.
Pour le sabotage de la voie ferrée, Alix Macario avait prévu de le faire avec Jean Carrara. Ce dernier a voulu que je les rejoigne. Nous avons pris nos bicyclettes et nous avons saboté la voie.

.
.
.
Comment pouvez-vous décrire l’ambiance et l’identité des Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI) ? Y’avait-il une bonne ambiance malgré les tensions ?
Il y avait des moments sympathiques avant de faire un déraillement. Nous étions obligés de quitter à Lyon avant le couvre-feu. Nous connaissions l’horaire du train. Je suis allé vérifier quelle était la bonne voie ferrée avec un Espagnol. Nous n’avions pas de montre mais il avait apporté un réveil qui faisait un bruit terrible. Nous étions au bord de la voie de Feyzin lorsque nous avons aperçu une patrouille allemande arriver. L’Espagnol s’est alors couché sur son réveil pour éviter que les soldats l’entendent. Je peux vous dire que nous avons trempé la chemise.
Lors de mes visites dans les écoles pour raconter la guerre aux enfants, j’utilisais l’humour. Je me suis baladé dans les rues de Lyon avec une gabardine au mois de Juillet. Avec la chaleur, j’avais la raie des fesses qui me servait de gouttière. Cela faisait rire les enfants mais c’était vrai.
.
.
.
Comment se passait le déraillement d’un train ?
.
.
Un morceau de rail était poussé et lorsque la locomotive arrivait, elle continuait sa route dans le décor. Le déraillement devenait routinier lorsque vous en faites trois nuits de suite. Mais je n’ai jamais déboulonné un rail – j’étais toujours en protection. Nous étions toujours contents lorsque l’opération se terminait.
Les Allemands réquisitionnaient des civils pour inspecter les voies ferrées la nuit et ils empêchaient ainsi les déraillements. Nous avons été plus d’une fois amères. La moitié du groupe restait près de la voie afin d’attraper les civils qui inspectaient. Ils étaient relâchés après l’opération. Un soir, j’étais replié avec le commandant, Polan et son adjoint François. Ils m’avaient confié qu’ils étaient sardes, anciens des brigades internationales. Nous avons entendu un bruit terrible. Une partie de notre groupe était engagé. Polan m’a demandé : « Prends deux hommes et vas-y ! ». Je suis allé sur une butte pour observer la scène. Sur le  lieu de l’affrontement, le train est arrivé et a déraillé. C’était un feu d’artifices – On y voyait comme en plein jour. Les wagons sont sortis de la voie. Après tout ce vacarme, il y a eu un silence qui faisait mal aux oreilles. La locomotive a soudainement soufflé. Nous nous sommes repliés et nous avons croisé deux hommes. Ils nous ont lancé les bons mots de passe mais nous avons entendu une patrouille arrivée. Nous ne pouvions rentrer à Lyon à cause du couvre-feu. Nous avons longé le Rhône. On entendait derrière les Allemands crier et leurs chiens aboyer. Nous avons continué jusqu’à un pont. Des Allemands étaient déjà là. Nous n’avons pas sauté dans le Rhône mais avons décidé de fuir dans les terres. Nous n’entendions plus les Allemands. Il faisait à présent jour donc nous avons atteint un village. Il y avait un bus. Nous l’avons pris et nous sommes retournés à Lyon. Mon frère m’avait dit de me réfugier dans une famille, la famille Nervi, en cas d’extrême nécessité. Je n’avais plus le choix – je ne pouvais plus marcher. J’ai été très bien accueilli. La mère de famille me frictionnait les pieds et on m’a nourri avec la soupe du père. Je devais obligatoirement rentrer chez moi pour 8 heures. J’ai rejoint ensuite mes camarades tous sains et saufs. En une nuit, nous avions fait 30 kilomètres à pied.
lieu de l’affrontement, le train est arrivé et a déraillé. C’était un feu d’artifices – On y voyait comme en plein jour. Les wagons sont sortis de la voie. Après tout ce vacarme, il y a eu un silence qui faisait mal aux oreilles. La locomotive a soudainement soufflé. Nous nous sommes repliés et nous avons croisé deux hommes. Ils nous ont lancé les bons mots de passe mais nous avons entendu une patrouille arrivée. Nous ne pouvions rentrer à Lyon à cause du couvre-feu. Nous avons longé le Rhône. On entendait derrière les Allemands crier et leurs chiens aboyer. Nous avons continué jusqu’à un pont. Des Allemands étaient déjà là. Nous n’avons pas sauté dans le Rhône mais avons décidé de fuir dans les terres. Nous n’entendions plus les Allemands. Il faisait à présent jour donc nous avons atteint un village. Il y avait un bus. Nous l’avons pris et nous sommes retournés à Lyon. Mon frère m’avait dit de me réfugier dans une famille, la famille Nervi, en cas d’extrême nécessité. Je n’avais plus le choix – je ne pouvais plus marcher. J’ai été très bien accueilli. La mère de famille me frictionnait les pieds et on m’a nourri avec la soupe du père. Je devais obligatoirement rentrer chez moi pour 8 heures. J’ai rejoint ensuite mes camarades tous sains et saufs. En une nuit, nous avions fait 30 kilomètres à pied.
Avez-vous senti un soutien de la part de la population lyonnaise ?
.
.
.
Non. Nous n’avions aucun contact avec elle. Suite au bombardement allié qui a ravagé à la ville le 26 mai 1944, le maréchal Pétain est venu et a été accueilli par des milliers de personnes. Quelle confiance pouvions-nous faire ?
Pour être suspect, il fallait être remarqué donc nous étions très discrets.
Et pourtant, le 6 juin, lorsque mon frère a décidé de partir au maquis, le patron du bar qui l’hébergeait lui qu’il se doutait qu’il était résistant car Roger partait le soir et revenait le matin. Et lorsqu’il est parti, le patron lui a rempli sa musette de conserves.
Comment avez-vous été arrêté le 25 Juillet 1944 ?
C’était un simple contrôle. J’étais dans la rue lorsqu’un homme, positionné contre un mur, m’a dit : « Et toi ! Police allemande. Montre-moi tes papiers ». J’avais mes véritables papiers. Il me les prend et les mets dans sa poche. J’ai protesté et le policier me répond «Tu fermes ta gueule et tu rentres dans le bistrot ». À l’âge de 19 ans, les jeunes devaient partir au Service du Travail Obligatoire. Je n’avais que 18 ans mais sans famille, seul dans Lyon, avec peu d’argent dans mon portefeuille : j’étais suspect. Je rentre dans le bistrot. Trois autres personnes étaient arrêtées avec un autre policier qui nous tenait en respect. Un autre nous a rejoints. Nous avons été emmenés au siège de la milice. Je me suis expliqué. J’ai raconté que comme ma famille vivait comme près d’un terrain d’aviation à Saint Raphaël, nous sommes partis en tant que réfugiés en Creuse à Saint Dizier Leyrenne. Mais comme les maquisards forçaient les jeunes des villages à les rejoindre, ma famille a pensé que je ferais mieux d’aller vivre à Lyon. Le policier a répondu : « Tu me prends pour un con avec tes histoires. » J’ai eu un interrogatoire musclé. Plus on me frappait, plus cela renforçait l’idée que je ne parlerai pas. Jamais je n’aurais accepté de dénoncer mes camarades. Les miliciens m’ont emmené au siège de la gestapo. Le siège avait été bombardé le 26 mai et la gestapo était alors réinstallée Place Belcourt. Les coups reprenaient de plus bel mais je ne parlais pas. J’ai eu un enfoncement de la boîte crânienne que j’ai toujours. Klaus Barbie est arrivé dans la salle.  J’étais par terre sur le ventre. Il a commencé à me taper avec son pied sur les côtes. « Qui est ton chef ? » me dit-il en français. J’ai répondu que je n’avais pas de chef. Barbie m’a encore frappé et m’a menacé : « Si tu ne parles pas, on va te faire passer à la baignoire ». J’ai entendu : « On va te faire passer au blé noir ». En Creuse, le blé noir ce sont des batteuses (rires). J’ai compris ensuite ce qu’était la baignoire. J’ai été emmené dans une cave avant d’être emmené au Fort Montluc. Il y avait des dizaines de détenus. Un jeune garçon musclé était tout nu et tremblait. Il n’arrivait pas à mettre sa chemise. J’ai voulu l’aider et le garde allemand m’a alors donné un coup de crosse. Je suis tombé par terre puis, étourdi par les coups qu’on m’avait administrés, j’ai continué à aider le jeune à s’habiller. L’Allemand a alors arrêté de me frapper. Par la suite, j’ai compris que le jeune homme venait de passer à la baignoire…
J’étais par terre sur le ventre. Il a commencé à me taper avec son pied sur les côtes. « Qui est ton chef ? » me dit-il en français. J’ai répondu que je n’avais pas de chef. Barbie m’a encore frappé et m’a menacé : « Si tu ne parles pas, on va te faire passer à la baignoire ». J’ai entendu : « On va te faire passer au blé noir ». En Creuse, le blé noir ce sont des batteuses (rires). J’ai compris ensuite ce qu’était la baignoire. J’ai été emmené dans une cave avant d’être emmené au Fort Montluc. Il y avait des dizaines de détenus. Un jeune garçon musclé était tout nu et tremblait. Il n’arrivait pas à mettre sa chemise. J’ai voulu l’aider et le garde allemand m’a alors donné un coup de crosse. Je suis tombé par terre puis, étourdi par les coups qu’on m’avait administrés, j’ai continué à aider le jeune à s’habiller. L’Allemand a alors arrêté de me frapper. Par la suite, j’ai compris que le jeune homme venait de passer à la baignoire…
De toute façon, nous ne connaissions pas l’adresse de nos camarades et encore moins les noms des grands responsables. Par conséquent, si les Allemands nous aurait fait parler, ils n’auraient eu que des résistants de faible ampleur. Un de mes camarades, Étienne, m’avait une fois amené chez ses parents. Lors de mon arrestation, ces parents ont eu peur et ont voulu quitter les lieux. Étienne les a rassurés : Il était certain que je ne parlerai pas.
.
.
.
Comment êtes-vous sorti du Fort Montluc ?
C’est l’insurrection de Villeurbanne qui a tout provoqué. A la nouvelle des combats de Paris, mes camarades ont pris l’initiative d’aller prendre d’assaut la prison de Saint Paul où 5 de nos camarades étaient emprisonnés. Les murs étaient hauts de 8 mètres et la seule façon d’entrer la prison c’était par la porte. Les camarades ont voulu peindre un camion afin de faire croire que c’était un véhicule de gendarmerie. Mais le garage était fermé. Ils ont alors vu un train allemand arrivé. La veille de l’opération, les copains avaient fait des brassards FFI pour la bataille. Avec les fusils, ils étaient vraiment en tenue de combat et les Allemands ont commencé à tirer. J’y étais toujours enfermé au Fort Montluc et nous entendions des coups de feu depuis nos cellules. Les copains se sont repliés à Villeurbanne où la population les a emmenés à l’hôtel de ville pour s’organiser. Le commandant Albert, responsable FTP-MOI de la zone Sud, leur a demandé de partir pour ne pas que la population civile soit en danger mais  beaucoup continuaient à rejoindre Villeurbanne. C’était trop tard. Les résistants ont alors monté des barricades et assemblé des fusils.
beaucoup continuaient à rejoindre Villeurbanne. C’était trop tard. Les résistants ont alors monté des barricades et assemblé des fusils.
Une partie des soldats Allemands du fort Montluc ont alors été envoyés à Villeurbanne en renfort. Je présume que le reste a quitté la prison le 24 août pensant que les Américains et l’Armée d’Afrique arrivaient. Étant le plus petit et le plus maigre des détenus de ma cellule, on m’a soulevé jusqu’à la fenêtre afin de regarder ce qui se passait à l’extérieur. Dans la cour, il y avait une baraque comme une bergerie. Des Juifs y étaient internés. Je lui ai demandé ce qui se passait et ils m’ont répondu : « Les Allemands abandonnent la prison ». Je les voyais en effet fuir. Nous étions fous de joie car nos geôliers avaient massacré les détenus. Il y a eu en tout 120 prisonniers qui ont été fusillés ce jour-là à Saint-Genis Laval.
Rien ne se passait. J’ai été une nouvelle fois soulevé pour regarder ce qui se passait dehors. Il y avait un vieux prisonnier avec une barbiche. Il disait qu’il était un général prisonnier et que les Allemands lui avaient donné les clefs des cellules mais qu’il avait donné sa parole d’honneur d’ouvrir les portes dans une heure. J’ai alors crié : « Oh barbette ! Si tu n’ouvres pas la porte, je l’enfonce. » De la baraque des juifs, le Chant du départ a été entonné puis la Marseillaise, puis j’ai entonné l’Internationale. Toute la prison chantait en chœur. Les derniers allemands sortaient de la prison lorsque nous chantions l’Internationale. C’était un chant de défi.
J’ai donné des coups de pied dans la porte. Mon co-détenu, un russe blanc, m’a dit de prendre la tinette pour taper sur la porte. J’y ai fait un trou et je suis sorti de ma cellule. Peu à peu, les prisonniers sortaient. Des civils commençaient à entrer avec une hache dans la prison pour nous libérer. Nous craignions que les Allemands aient miné la prison. J’ai quitté le fort Montluc et je suis rentré chez moi. J’avais une cloison nasale qui pendait, le bras toujours gonflé par les coups. Mes voisins m’ont demandé ce qui m’était arrivé. J’ai répondu que j’avais été interné au Fort Montluc. J’ai dîné avec mes voisins et le lendemain matin, j’ai lu dans la presse que Lyon avait été libéré par l’amiral Lefort. Je chantais l’Internationale dans la rue. J’ai entendu des bruits de camion. Je pensais que c’était mes camarades qui revenaient du maquis. Je me suis à mis à courir et je me suis rendu compte que c’était les Allemands qui fuyaient la ville. Me voyant, les soldats ont pris peur et m’ont mis en joue. J’ai ensuite pu enfin retrouver mes camarades. Tous me croyaient mort sous la torture. Ce fut un choc. Même ma famille pensait que j’avais été tué.
Je suis devenu commandant de la 4ème compagnie, chef d’une centaine d’hommes et nous avons défilé pour la libération de la ville. Pierre Villon et Marie-Claude Vaillant-Couturier étaient présents. Je chantais avec les Italiens et les Espagnols. Tout le monde pensait que je parlais toutes les langues (rires).
Toujours abimé par mes blessures, je suis rentré en Creuse retrouver ma famille. J’ai été emmené par un maquisard en voiture. Lorsque ma mère m’a vu, nous nous sommes embrassés. Comme toute Italienne, elle portait la tenue de deuil car elle me croyait mort. J’ai ensuite retrouvé mon père, ma sœur et mon frère. Au moment du repas, ma mère a levé la tête et a dit : « Quand cette guerre a commencé, j’étais convaincu qu’il y aurait eu des chaises vides. Vous êtes ici tous les trois. Vous avez terriblement souffert mais vous êtes tous en vie. C’est le plus beau jour de ma vie ». Cela reste encore aujourd’hui un souvenir très émouvant.
Je suis devenu sous-lieutenant avec le titre de grand mutilé de guerre. Je suis retourné à Saint-Raphaël et je suis redevenu bûcheron avec mon père. J’ai passé deux ans en soin. Personne ne pensait que j’allais survivre…
.