Depuis la nuit des temps, se nourrir a été une nécessité pour l’humain. L’idée de déguster est apparue lors de la domination de son monde. Les disettes et les famines ont perduré mais, pour des minorités privilégiées, manger est devenu un plaisir, un pouvoir et donc un luxe et parfois une gourmandise, ce péché capital. La cuisine est un art qui cohabite avec la gastronomie.
Celle-ci est à présent une identité de chaque pays et même de chaque région. Grandis par leur talent, les cuisiniers sont devenus de vrais gentilhommes. L’Histoire permet de comprendre de telles évolutions.
Entretien avec Patrick Rambourg, Historien des pratiques culinaires et alimentaires et des usages de table et Chercheur associé à l’Université Paris Cité.
.
.
.
.
A partir de quand manger est devenu un savoir-vivre ?
.
.
.
.
La domestication du feu (le foyer), il y a environ 400 000 ans, contribue à mettre en place un cérémonial ou au moins une sociabilité des repas. Nous pouvons en tout cas aisément remonter aux civilisations mésopotamienne et égyptienne. Dès les années 2000 avant notre ère, il y a des représentations iconographiques de banquet, notamment sur les tombeaux. Pour ceux qui détiennent le pouvoir, le repas est un moyen d’affirmer prestige et position dans la société. Le banquet est pour le roi l’occasion, également, de remercier les combattants et les bâtisseurs de palais. Le festin n’est pas seulement un moment convivial réservé aux élites, le peuple peut y être associé par diverses réjouissances.
Dès l’Antiquité, apparaît une codification sur les manières de manger. Mais la table a aussi été associée à l’amour et à la sexualité, comme le montre des fresques de Pompéi. Les Grecs sépareront la prise de nourriture de la boisson : c’est le symposion, un moment de partage ritualisé autour du vin. Au Moyen Âge on rédige des traités de courtoisie, que l’on appellera par la suite traités de civilité, avec notamment la publication en 1530 du célèbre ouvrage d’Erasme, La Civilité puérile. L’auteur explique en substance qu’à table on doit se comporter en humain et non en animal.
.
.
.
.

.
.
.
.
La gourmandise est présente dans l’Enfer de Dante mais reste léger face aux autres péchés. A-t-il tout de même été un tourment tout au long des siècles dominés par le Christianisme ?
.
.
.
.

La gourmandise, un des 7 péchés capitaux, est souvent associée à la luxure. Au Moyen Âge, des images représentent un homme et une femme en train de manger ensemble, pour ensuite les retrouver dans un lit, associant ainsi la table à l’amour. La notion même de chair fait écho au désir. L’Eglise impose des jours maigres (sans viande et matières grasses animales, entre autres), avec l’idée de pénitence et parce manger trop de chair échaufferait. Mais l’abondance alimentaire en cette période concerne avant tout les élites. Pendant les jours maigres, par exemple, tandis que la majorité de la population se contente de manger des harengs secs et des légumes, les riches organisent, eux, des banquets avec des poissons riches, dit nobles, au menu. Le péché de gourmandise est dans l’excès et dans le plaisir que peut procurer la nourriture.
Cependant, la gourmandise n’est pas un interdit – elle est juste perçue comme un péché. Il n’est d’ailleurs pas anodin que l’Enfer soit représenté par des flammes. C’est un lieu qui peut s’apparenter à une cuisine où les démons cuisinent les pêcheurs.
Dans une société médiévale où un grand nombre d’individus vivent avec peu de ressources, on peut s’interroger sur cette notion d’excès dont rêve ceux qui ont peu à manger. Au milieu du XIIIe siècle paraît le Fabliau de Coquaigne qui vante un pays imaginaire où règne l’abondance et le bien être alimentaire – un paradis terrestre où la nourriture n’est pas une préoccupation. Fantasme qui existe dans une société où la faim est constante. Le texte rencontre un énorme succès. Il se diffuse dans toute l’Europe, dans de nombreuses langues, tout en étant adapté au contexte alimentaire des divers pays. En 1567, Pieter Brueghel l’Ancien imaginera ce Pays de cocagne dans l’une de ses célèbres peintures.
.
.
.
.
La ruralité est donc consacrée en ville par ses spécialités alimentaires ?
.
.
.
.
Les traditions culinaires vont perdurer grâce aux villes. C’est un fait qui peut étonner de nos jours. Au XVIIIème siècle, par exemple, les pâtés de Périgueux ou d’Amiens sont prisés dans les grandes villes de France, notamment dans la capitale. Le lien entre terroir, gourmandise et gastronomie s’affirme. La valeur gastronomique de Paris se comprend aussi à travers les richesses culinaires des régions qui lui fournissent ingrédients et spécialités. Les mangeurs des villes, particulièrement les plus aisés, contribuent au développement et à l’affirmation des spécialités régionales en étant des clients et des consommateurs. Dans les campagnes, en revanche, longtemps la nourriture principale est le pain, le bouillon et les végétaux. La viande reste une denrée rare et plutôt consommée à l’occasion de festivités. En zone urbaine, la diversité culinaire et alimentaire est en effet bien plus importante que dans les campagnes.
.
.
.
.
La ville de Paris puise-t-elle notamment sa puissance de ses richesses culinaires ? (« Tout semble tomber du ciel »)
.
.
.
.
Historiquement Paris rayonne sur le plan artistique et culinaire. Tout comme Londres, elle est une capitale inamovible depuis des siècles. En plus d’obtenir des produits des régions françaises, Paris réussit, dès la période médiévale au moins, à amener des nourritures étrangères pouvant venir de très loin. La ville fait l’objet d’un intense commerce international. De plus, son mode de vie se diffuse peu à peu, en France et dans toute l’Europe. La tenue vestimentaire de la Parisienne a longtemps attiré toutes les attentions, imitée dans la haute société et les cours étrangères. Les arts de la cuisine et de la table deviennent aussi un modèle à suivre. Le discours gastronomique parisien va influencer les pensées, particulièrement au travers des écrits de Grimod de la Reynière et de Brillat-Savarin. Par ailleurs, dès le XVIIème siècle, les livres de cuisine française sont traduits dans de nombreuses langues et certains mots (gastronomie, haute cuisine, sauce) s’intègreront dans les dictionnaires étrangers. Très tôt, des chefs parisiens sont également engagés dans les cours et grandes maisons étrangères. L’influence française précède déjà l’arrivée du restaurant.
.
.
.
.

.
.
.
.
L’apparition des restaurants est-elle une révolution ?
.
.
.
.
En effet. Elle est sociale, économique et culturelle. Dès le XVIIIème siècle, Paris a une multitude de tavernes, de cabarets, d’auberges, d’hôtelleries, de boutiques de bouche… tous ces lieux permettaient de manger hors de chez soi et d’avoir une nourriture prête à consommer. L’invention du restaurant, dans les années 1760, pourrait être perçue comme « un coup de marketing ». Quelques décennies auparavant l’on débattait d’une nouvelle cuisine, considérée comme plus simple et plus légère. Des traiteurs reprendront cette idée pour proposer des plats qui s’inspirent de cette nouvelle cuisine, dite de santé. Le
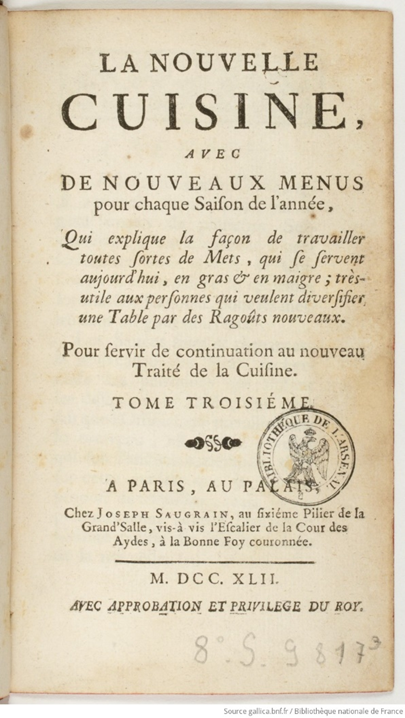
« restaurant » est à l’origine un bouillon que l’on prépare pour une personne malade ou qui veut rester en bonne santé, avant que le mot ne définisse bien plus tard un établissement de restauration. Les premiers restaurateurs s’adressent d’abord à une clientèle élitiste. Ils proposent des repas légers dans un beau lieu confortable. Des salons sont réservés à une clientèle féminine. La vaisselle est dorée, les tables sont individuelles et une carte de menus est proposée. Le restaurant est un endroit à part pour les autorités puisqu’il a le droit de fermer plus tard que les autres enseignes. Pour le public, ce nouveau genre d’établissement est un véritable bouleversement.
Ainsi, ce n’est pas la Révolution française qui invente le restaurant, comme cela a pu être dit, et comme je l’entends encore parfois. Avec les guerres et les privations, ce dernier ne disparait pas, bien au contraire. Le restaurant va très vite se démocratiser pour s’adresser à un large public. Né à Paris, il devient un phénomène international. Le bistronomique est également une invention parisienne.
.
.
.
.
Les menus (entrée, plat, dessert) sont-ils une façon d’imposer une pensée française ?
.
.
.
.
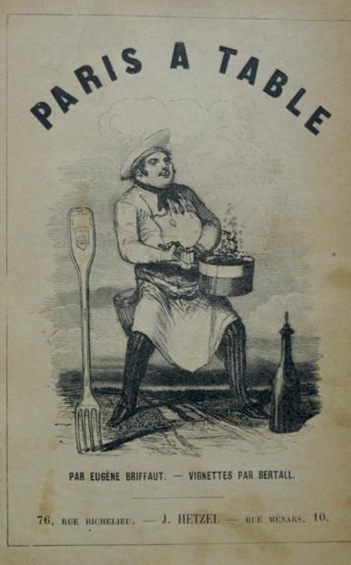
Je ne suis pas certain que l’on puisse dire que l’ordonnancement de notre repas est « une façon d’imposer une pensée française », mais ce qui est certain c’est que le repas à la française s’articule autour de l’entrée, du plat et du dessert. Le fromage et la salade accompagnant ce modèle, qui s’affirme dans la capitale dans le courant du XIXe siècle, pour s’adapter aux modes de vie urbaine. Les mots qui désignent les moments où l’on mange vont en même temps évoluer. Ainsi, le déjeuner a longtemps signifié le repas du matin, le dîner celui de la fin de l’après-midi et le souper celui du soir (après le spectacle). Progressivement, le fonctionnement va évoluer, suivant l’évolution de la société parisienne : le déjeuner devient le repas du midi et le dîner celui du soir, on en vient dès lors à inventer un nouveau mot, le petit-déjeuner, pour le repas du matin.
Ces trois repas par jours deviennent la norme du repas à la française et régularisent notre consommation
d’aliments. Cela nous préserve plus des maladies cardio-vasculaires que dans les pays où il n’y a pas cette régularité des repas. Pour les étrangers c’est une particularité bien française, et ils s’étonnent de nous voir tous manger aux mêmes horaires.
La restauration rapide s’est adaptée à notre modèle alimentaire, même les fast-food, qui n’ont jamais été une menace pour notre gastronomie. Certes, le hamburger s’est imposé partout, mais à la sauce française. Les chefs français ont même réussi à l’intégrer dans leur menu. Il a été embourgeoisé et régionalisé. Certaines marques de restauration rapide voient leurs établissements comme des restaurants et travaillent avec des producteurs locaux.
.
.
.
.
L’automobile a-t-elle permis l’âge d’or de la gastronomie ?
.
.
.
.
Avant, il y a le chemin de fer qui contribue à l’essor des villes thermales et des cités balnéaires, et de leur palace, au XIXe siècle. Le train est alors le transport des élites. Cependant, Paris reste la capitale de la gastronomie, notamment à la Belle Epoque. Mais en même temps les cuisines régionales commencent à s’affirmer avec la publication de livres de recettes, dans lesquelles l’on peut percevoir l’influence parisienne, nombre de chefs ayant travaillé dans la capitale.
Quant à l’automobile, transport tout d’abord des élites, elle contribue aussi au succès de la gastronomie française et à la découverte des richesses de notre patrimoine culinaire et alimentaire dans tout le pays.
Afin de fidéliser leur clientèle, Michelin publie ses premiers guides dès 1900 et commence à donner des étoiles dès les années 1920. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, la cuisine régionale devient populaire. Paris connait une augmentation de ses restaurants du terroir pour devenir la capitale des cuisines régionales. De célèbres restaurants s’ouvrent le long des routes de vacances, dont la célèbre Nationale 7. La cuisine française n’est plus seulement celle qui s’élaborait dans la capitale, elle se définit désormais dans sa diversité régionale, de l’Alsace à la Provence, du Sud-Ouest au Nord-Est, de la Normandie à la Bretagne, etc., même si la Bretagne fut longtemps une province pauvre. De nos jours, la crêpe ou la galette peuvent être perçues comme des mets gastronomiques.
Par-ailleurs le succès du guide Michelin est aujourd’hui devenu mondial. Lorsqu’il arrive dans un pays, c’est un événement. Il est traduit dans le monde entier et chaque année les médias parlent des restaurants étoilés du guide.
.
.
.
.
Pain traditionnel, beurre, cuisine de rue… comment expliquer le retour des repas simples ?
.
.
.
.
Historiquement il y a toujours eu une aspiration aux repas simples. La simplicité culinaire n’empêche pas le bon et la gastronomie. La haute cuisine est techniquement sophistiquée mais elle peut aussi avoir l’apparence d’une cuisine simple pour le convive. Depuis des siècles on recherche le « vrai goût des aliments », mais ce goût se définit par rapport à l’époque et à la société dans lesquelles on vit. On apprécie aujourd’hui le pain, dit de tradition, et la baguette tradition est devenue la norme, surtout en ville.
Pendant des siècles, la couleur du pain définira la condition sociale de celui qui le mange. Ainsi le pain blanc était pour les élites, le pain bis (moins blanc) pour la bourgeoisie et le noir pour les couches les plus défavorisées. L’accès au premier a longtemps été une revendication sociale. Et il n’y a pas si longtemps que cela, la majorité des boulangeries proposaient un pain à la farine très blanche, qui n’avait plus vraiment de goût. En quelles décennies nos valeurs gustatives du pain ont beaucoup changé. Le retour du pain traditionnel ou aux céréales est un paradoxe car c’est la ville qui demande le goût venu de la campagne. Dans les zones rurales, le pain blanc reste souvent la norme.
Le discours sur la nourriture mêle de nos jours la qualité, le plaisir, l’équilibre et la santé. Autrefois, manger était lié à la réussite sociale. L’espérance de vie a augmenté car nous surveillons, entre autres, notre alimentation. On nous oriente vers une alimentation plus végétarienne et à consommer moins de viande. Le plaisir à table et la santé peuvent coexister. La rigueur culturelle de la France (trois repas par jour) est admirée à l’étranger.
.
.
.
.
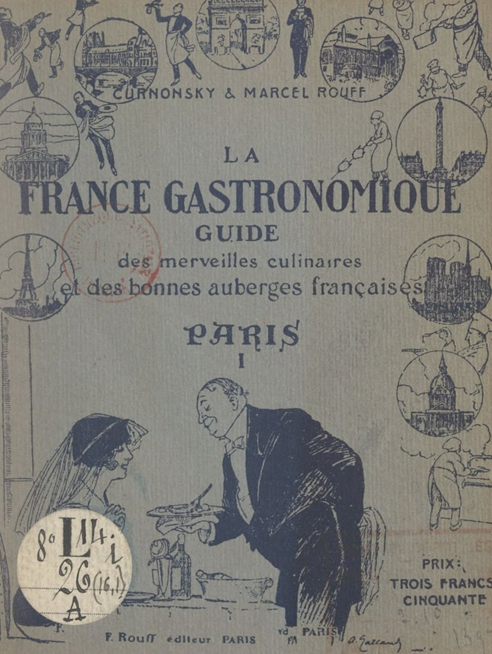
.
.
.
.
Avec les pâtes mais surtout la pizza, l’Italie a-t-elle pu conquérir le monde ?
.
.
.
.
Elle a réussi avec le déplacement de ses populations. L’Italie a longtemps été un pays d’émigration. Fuyant la misère, les Italiens se sont installés dans de nombreux pays étrangers. Ils ont également amené leur savoir-faire gastronomique. La pizza et les pâtes étaient pourtant des plats populaires. Les Français n’ont pas vraiment été un peuple d’émigrés. Notre gastronomie s’est diffusée par les chefs qui travaillaient à l’étranger, par les élites qui les embauchaient, par les livres de cuisine et de gastronomie aussi. La cuisine italienne est certes mondialement reconnue mais elle l’est principalement par les pâtes et les pizzas, même s’il existe une gastronomie italienne. En France, on peut manger des pizzas partout, même dans les campagnes, où l’on voir fleurir depuis quelques temps des machines qui distribuent des pizzas à toute heures.
.
.
.
.

.
.
.
.
Que pensez-vous de l’intégration du repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité ?
.
.
.
.
C’est la reconnaissance de la culture culinaire française, de son art de vivre et de recevoir à table. D’une histoire de plusieurs siècles et d’une part importante de notre identité. J’ai été l’un des experts du dossier et l’intitulé a fait débat. Les notions de cuisine ou de la gastronomie française ne convenaient pas car trop restreintes. Toutes les composantes de la société devaient pouvoir s’y retrouver, d’où le repas gastronomique des Français. Cela implique l’approvisionnement, la cuisine, la table, la cérémonie, le vin, la convivialité ou encore le discours. C’est avant tout un repas où la nourriture et les vins sont mis à l’honneur dans un moment chaleureux et festif. Nous avons historiquement développé une vraie passion pour les arts culinaires et de la table, et cela est reconnue dans le monde entier. Ce n’est ainsi pas anodin si quelques années auparavant, avant la reconnaissance de l’Unesco en 2010 du repas gastronomique des Français, le film d’animation américain « Ratatouille » (2007) choisit le nom d’un plat provençal comme titre et Paris, capitale de la gastronomie, comme lieu d’action.
.
.
.
.
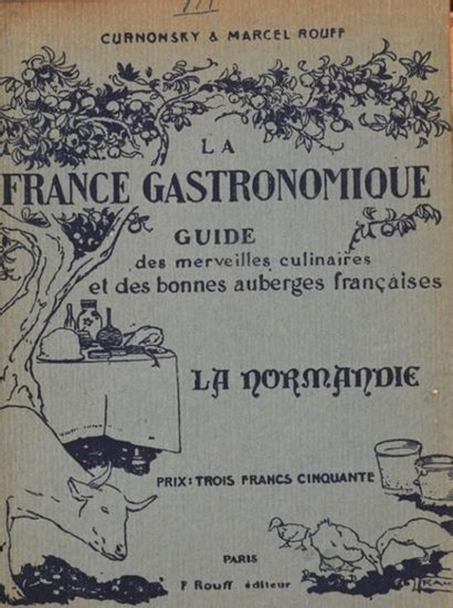
.
.
.
.
Pour en savoir plus :
*Histoire du Paris gastronomique, du Moyen âge à nos jours, Patrick Rambourg – Paris, Perrin, 2023.
*L’Art et la table, Patrick Rambourg – Paris Citadelles & Mazenod, 2016 et 2023.
*Histoire de la cuisine et de la gastronomie françaises, Patrick Rambourg – Paris, Perrin (coll. tempus), 2010. Récemment sorti en chinois (2025).







