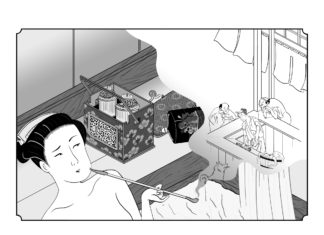De par son trait, ses couleurs et ses traits, Baru brosse un univers bien à lui : celui des quartiers populaires, de la route, du ring mais aussi de l’Est de la France et de l’Italie. Fils d’immigrés italiens, ayant grandi dans le milieu ouvrier et urbain, le dessinateur n’a jamais quitté son monde.
Depuis « Quéquette Blues » (1991) à plus récemment « Rodina » (2023), Baru aime autant ses personnages que leurs propres errances. Aussi à l’aise dans le passé que dans le présent en passant par l’uchronie, il n’a de cesse étonner l’univers BD.
.
Entretien avec Baru.
.
.
.
.
Alors que d’autres fils de migrants comme François Cavanna ou Azouz Begag sont devenus écrivains, vous, vous êtes dessinateur. Pourquoi un tel choix ?
.
.
.
.
Le lycée m’avait fâché avec la littérature. J’en suis parti car j’avais l’impression qu’on m’obligeait à tourner le dos à ma culture dont la bande dessinée. Je suis issu du milieu ouvrier et d’une famille italienne. Dès l’enfance, je lisais la BD de gare. Mon père m’avait également abonné au magazine communiste Vaillant.
Lycéen, de telles lectures étaient méprisées car ne faisant pas partie de la « belle » littérature. J’ai subitement eu honte d’avoir eu honte de ce que j’étais. En quittant le lycée, j’ai fait le choix de prendre la parole publiquement à travers la bande dessinée, ce genre si méprisé. Cette colère reste encore le moteur de mon travail d’artiste.
.
.
.
.

.
.
.
Vos couvertures présentent souvent des personnages qui fixent le lecteur. Comment pourrait-on décrire votre style ? La trilogie « Bella Ciao » fait écho à vos premiers albums, « Quéquette Blues » ?
.
.
.
.
En effet. C’est une aventure qui a commencé en 1984, il y a 40 ans. Dès mes premières œuvres, j’ai voulu faire l’éloge des miens, ma propre classe – le monde ouvrier. Lorsque je vivais dans la cité de mon enfance, avec mes copains, nous trainions le long d’un petit muret qui surplombait d’autres tours d’immeubles. Nous trainions notre ennui et faisions la promesse de quitter cet univers.
En dessinant, j’ai l’impression de continuer à être sur ce muret. Ce n’est pas en tant qu’individu que j’exprime mais comme représentant de ce groupe de jeunes en quête d’espoir.
.
.
.
.
La Lorraine est-elle elle aussi un personnage principal ?
.
.
.
.
Je suis en fait né et ai grandi dans l’Est. C’est là que j’ai puisé ma force et mes envies de parcourir le monde.
.
.
.
.

.
.
.
Dans « Le Chemin de l’Amérique » (1990), vous retracez le parcours du boxeur Saïd Boudiaf en pleine guerre d’Algérie. L’histoire de « L’Enragé » (2004) a les mêmes sonorités. Raconter et dessiner la boxe est-il un défi ?
.
.
.
.
Il s’agit surtout de chorégraphie. Sur un ring, en-dehors des coups portés, il y a un véritable « ballet » des corps. Ancien prof de gym, je reconnais l’esthétique des mouvements et déplacements. La boxe mêle élégance et brutalité. C’était aussi un sport qui permettait à bon nombre de jeunes d’échapper à la misère et au déterminisme. L’intégration passe malheureusement parfois par la souffrance du corps.
.
.
.
.
« L’Autoroute du soleil » (1995) vous a demandé 3 ans de travail. De par son découpage et sa noirceur, le livre a marqué les esprits. Est-ce une œuvre crépusculaire ?
.
.
.
.
Pas du tout car il s’agit de jeunesse en mouvement. Par contre, le livre désigne les travers de la société.
.
.
.
.

.
.
.
« Noir » (2009) est-il un avertissement à l’avenir sombre (Nicolas Sarkozy devient dictateur) ?
.
.
.
.
Effectivement. Ma classe, le monde ouvrier, avec la disparition de la grande industrie, est tentée par l’extrême droite. Non seulement, les ouvriers ont perdu leur travail et on les a désignés comme des assistés.
Je reste pourtant optimiste. La classe ouvrière n’est pas perdue. J’ai des amis qui votent certes pour le Rassemblement national mais gardent tout de même de véritables affections pour un copain d’origine maghrébine. Ali n’est en aucun cas un problème. C’est « ailleurs » que les choses ne vont pas. Je regrette que les problématiques d’aujourd’hui se concentrent sur l’immigration. C’est pour moi un non thème. Qu’importe les origines, deux ouvriers côte à côte vont très bien s’entendre.
.
.
.
.
« Canicule » (2013) est une adaptation BD du roman de Jean Vautrin. Est-ce que ce fut une difficulté ?
.
.
.
.

Adapter est un exercice délicat. Dans tous les cas, vous devez respecter votre genre : la bande dessinée. De plus, il faut tenir compte des préoccupations de l’auteur d’origine. J’avais déjà réalisé une adaptation en 2009, « Pauvres Zhéros ». A chaque fois, j’avais la même obsession : Ne pas trahir. Je voulais être le plus fidèle possible à l’esprit du roman. J’ai dû gratter l’intrigue jusqu’à l’os puis j’ai repris les lambeaux de chair mis de côté.
Que ce soit avec Jean Vautrin ou avec Pierre Pelot, je faisais en sorte de les tenir au courant de l’évolution du projet. J’envoyais des planches à Jean avant qu’il décède. Sa réponse positive m’a réconforté.
.
.
.
.
La trilogie « Bella Ciao » est-elle l’ultime lettre d’amour à votre famille italienne ?
.
.
.
.
J’ai payé ma dette (rires). J’ai retranscrit en dessin la culture italienne en France. Avec « Quéquette Blues », je traitais de l’adolescence de ces jeunes fils d’immigrés. Avec « Les Années Spoutnik », je traite d’une histoire plus ancienne. « Bella Ciao » est une trilogie qui s’aventure de la fin du XIXème siècle à la Seconde Guerre mondiale. Je voulais au départ réaliser un livre sur mon père. Mais au fil du projet, je me suis rendu compte qu’il s’agissait de l’histoire de mon grand-père. C’est lui qui est parti d’Italie.
.
.
.
.
Et à présent ?
.
.
.
.
J’ai un projet mais j’ai besoin de plus de réflexion. Ce sera une affaire de génération. La mienne…
.
.
.
.