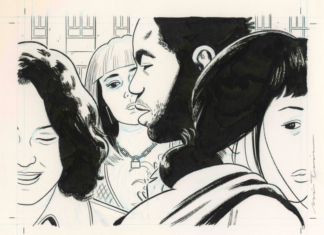La Révolution française est un événement profondément marquant de notre histoire. Indiscutablement, il y a un avant et un après 1789. Face au passé de l’Ancien régime, les révolutionnaires ont décidé de façonner une nouvelle ère – celle de la liberté. Suite à l’abolition de la monarchie, le 22 septembre 1792 est décrété par la Convention comme l’an premier de la République française. Il se trouve que ce jour est également celui de l’équinoxe d’automne. « L’ère vulgaire » prend alors fin et la commission Romme (du nom d’un député) est mise en place afin de concevoir le calendrier révolutionnaire. Ce dernier est adopté le 5 octobre 1793… pardon le 14 vendémiaire.
Alors que le mètre et le kilomètre ont perduré jusqu’à nos jours, le calendrier révolutionnaire est abandonné le 22 Fructidor An XIII (9 septembre 1805). Pour quelles raisons, l’ère républicaine a-t-elle mis fin à son propre temps ? Que nous reste-t-il de ce calendrier ?
Entretien avec Côme Simien, Maître de conférences en Histoire moderne à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne afin de mieux comprendre ce calendrier si révolutionnaire.
.
.
.
.
Alors que l’on impose le mètre et le kilomètre, que l’on met en place les départements aux dépends des régions, le calendrier républicain est-il un élément logique de la régénération de la société française durant la Révolution ?
.
.
.
.

Il est en effet pensé ainsi. Le calendrier républicain est imaginé comme la continuité et même le parachèvement du système métrique et décimal élaboré par les révolutionnaires. Donc comme l’ultime déclinaison de la régénération des mesures du monde entreprise par la Révolution. Lorsque le calendrier est présenté à la Convention par le député Gilbert Romme le 20 septembre 1793, cela fait un mois déjà que le système métrique (mètre, litre, gramme…), reposant sur la base décimale, a été adopté par la même Convention. Avec le calendrier révolutionnaire, le système décimal est transposé à la mesure du temps. Certes la découpe de l’année en 12 mois est préservée. Mais passé cela, la base décimale est introduite pour les mois (30 jours) et leur fractionnement (il n’y aura plus de semaines de 7 jours mais des décades de 10 jours). On proposera même de décliner les minutes et les heures du jour selon ce système à base 10. L’idée est d’introduire plus de raison, plus de logique, dans la mesure de l’écoulement du temps. Grâce à la base décimale, par exemple, un mois débutera toujours par un « primidi » (premier jour de la décade), et pas tantôt par un lundi, tantôt par un mercredi, tantôt par un vendredi…
.
.
.
.
L’an I de la République française est proclamé le 22 septembre 1792. D’une certaine manière est-ce que le calendrier républicain n’attendait qu’une chose : la bonne date pour être appliqué ?
.
.
.
.
Oui, on peut le dire. Mais il faut préciser aussitôt que le sentiment de vivre, avec la Révolution, un moment de bouleversement majeur dans la marche du temps, un bouleversement à ce point-là conséquent qu’il appellerait un réajustement de la manière de saisir et de dire le temps qui passe, est antérieur à septembre 1792. Par conséquent, d’autres dates que le 22 septembre avaient pu être retenues comme « point-bascule » avant l’avènement de la République. Prenons des exemples pour bien le comprendre. Dès les jours qui suivent la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, les révolutionnaires éprouvent la certitude qu’ils viennent de vivre une rupture sans pareille dans l’histoire, et le 14 juillet se mue aussitôt le « premier jour de la Liberté ». C’est tout sauf un phénomène passager : l’année 1790 devient dans beaucoup de lettres, dans les journaux, dans les actes des administrations, « l’An II de la Liberté » – mais l’année « 1790 » demeure également – ; 1791 l’an III de la liberté, etc. Avec la prise des Tuileries et la chute de la monarchie française, le 10 août 1792, on se met à parler de « l’An I de l’Egalité » – sans pour autant cesser de parler ni de « l’an IV de la liberté », ni de l’année « 1792 ». Enfin, le 22 septembre 1792 arrive. Avec lui, la France entre en République. Dès ce jour, la Convention nationale réorganise le temps autour de cet événement fondateur : l’établissement de la République. En ce 22 septembre 1792, le député Collot d’Herbois propose un décret (adopté) qui stipule que les actes publics seront désormais datés de « l’An I de la République française ». Si à cette date l’initiative est surtout symbolique (il n’y a pas encore à proprement parler de calendrier révolutionnaire), cette mention, « l’an I de la République française », commence effectivement à être employée dans les écrits officiels. On la voit même apparaître dans certains écrits intimes (journaux, lettres privées…). L’ordre du temps a donc connu un véritable changement dès les débuts de la Révolution, et ce changement se précipite ensuite avec l’avènement du régime républicain, en septembre 1792. Mais la République va bientôt vouloir aller plus loin. Quelques semaines seulement après sa fondation, alors que l’actualité politique est particulièrement chargée (le procès du roi vient de s’ouvrir), le Comité d’Instruction Publique de la Convention nationale est chargé de réfléchir à l’adoption d’un nouveau calendrier. Ses membres sont, pour la plupart, des savants et des hommes lettres.
Un an plus tard, le 20 septembre 1793, le conventionnel Romme, un député montagnard et un scientifique, membre éminent du Comité d’Instruction publique et figure majeure de la réflexion collective engagée sur le nouveau calendrier, présente son rapport à l’Assemblée. Il propose que le calendrier républicain débute le 22 du même mois. Ce choix est doublement symbolique, et cette double symbolique est évidemment mobilisée par Romme pour ce qu’elle confère d’aura quasi-miraculeuse, et donc de légitimité, à la République française : le 22 septembre est, en même temps, souligne-t-il, le jour où la France est devenue une République et le jour de l’équinoxe d’Automne. On ne pouvait trouver coïncidence plus heureuse pour les acteurs de ce temps, qui avaient fait du principe d’égalité l’un des fondements majeurs du nouveau régime. Car la date du 22 septembre est, en effet, pour eux, doublement synonyme d’égalité : d’égalité politique d’un côté (avec l’avènement de la République, il n’y aura plus de roi, partant tous les hommes seront enfin placés au même niveau dans l’ordre juridique) et, en écho, d’égalité naturelle (l’équinoxe est ce moment précis de l’année où le jour et la nuit ont une durée égale).
.
.

.
.
.
.
Y’a-t-il des opposants au principe même ?
.
.
.
.
Oui. Du côté des contre-révolutionnaires on l’imagine, évidemment. Les frères du roi et leurs partisans de l’intérieur ou de l’extérieur, les princes et les nobles émigrés, continuent de dater selon l’ancien calendrier et n’envisagent jamais de changer de système de mesure du temps pour adopter celui des révolutionnaires – qu’ils abhorrent. Cela dit, quelques réticences ont pu exister jusque chez les révolutionnaires. C’est le cas, notamment, de Sieyès, un député, auteur de la célèbre brochure Qu’est-ce que le tiers état, publiée au début de l’année 1789 et qui avait si fortement pesé, alors, sur les premiers développements de la Révolution. En 1793, à un moment où la réflexion sur le nouveau calendrier est engagée mais où rien n’a encore été décidé, il exprime ses réserves quant à la pertinence même de l’entreprise de refonte calendaire. Elle lui apparaît trop ample, trop conséquente dans ses implications, trop précoce surtout. Précipitée, en somme. Reste que la majorité des députés de la Convention nationale est favorable à l’initiative.
.
.
.
.
L’année conserve 365 jours, 12 mois. Il y a cependant pour chacun de ces derniers seulement 30 jours. Les 5 jours restants sont placés à la fin de l’année et sont nommés les sans-culottides. Le nom devient ensuite en l’An III les jours complémentaires. Peut-on y voir la fin des sans-culottes ? (Fête du Travail, de l’Opinion, du Génie) ?
.
.
.
.

Oui, il faut évidemment le lire ainsi. C’est l’un des marqueurs de la grande rupture que représente l’an III (1794-1795) dans la dynamique révolutionnaire. La décision d’appeler les 5 derniers jours de l’année républicaine les « sans-culottides » avait été adoptée à l’été-automne 1793, à un moment où la Convention nationale était dominée par les Montagnards et où le mouvement sans-culotte était à son apogée. Le terme est abandonné un an plus tard à un moment, l’an III donc (« l’automne de la Révolution », disait Sergio Luzzatto), où la Convention tente d’en finir avec le mouvement populaire et son autonomie. Le renversement de Robespierre et de ses proches est passé par-là. Selon l’expression consacrée, les Thermidoriens (ceux qui dominent désormais la Convention) souhaitent fonder une « République sans Révolution ». L’échec des insurrections de germinal-prairial an III (printemps 1795) marque les derniers feux du mouvement sans-culotte. Déjà affaibli, il est cette fois assez largement vaincu. Cela a des incidences très concrètes : arrestation des leaders, désarmement des militants, fermeture des clubs (tout cela a pu débuter dès l’automne 1794). Mais il y a également tout un versant symbolique à cette entreprise de « dépopularisation » de la Révolution, c’est-à-dire de dépolitisation des humbles – quoique les sans-culottes étaient loin d’être majoritairement des pauvres. Le terme « sans-culotte » lui-même, après avoir été un mot-clé et positif de la rhétorique révolutionnaire, devient synonyme de « terrorisme ». Les symboles du sans-culottisme (la pique, le bonnet phrygien…) disparaissent. Fait essentiel : on réécrit l’histoire du passé le plus récent. Les deux années écoulées (1793-1794), désormais qualifiées de « règne de la terreur », sont érigées en période de folie collective, durant lesquelles un peuple naïf et crédule, immature, enfant, aurait été égaré par les « robespierristes ». L’an II de la République aurait été un temps d’anarchie. Ce n’est pas la vérité, mais c’est sur cette réécriture de l’histoire que se bâtit le régime républicain du Directoire. Dans le discours dominant de l’époque, comme la bien noté Jean-Luc Chappey, domine à présent le langage thérapeutique : il faut soigner le corps social par la raison. Donc confier le pouvoir à des gens raisonnables, c’est-à-dire aux « meilleurs », aux « plus riches », aux « propriétaires ». Aux gens capables. Aux bourgeois. Le suffrage censitaire s’apprête à être rétabli. C’est dans cet élan général que l’on débaptise les 5 jours de la fin de l’année, initialement nommés les « sans-culottides », qui deviennent, plus simplement, les « jours complémentaires ».
.
.
.
.
Quel est le rôle du poète Fabre d’Eglantine dans la conception du calendrier républicain ?
.
.
.
.
Il se situe au niveau de la dénomination des mois et des jours du calendrier républicain. Pour les républicains de 1793, il ne pouvait être question de conserver les appellations anciennes, qui renvoyaient souvent à l’histoire sainte (chaque jour avait son ou ses saints correspondants) et à l’histoire des « tyrans » du passé (Jules César pour juillet, l’empereur Auguste pour août… autant de fossoyeurs de République). L’heure était donc à effacer et à reconstruire un système entièrement neuf de références sur lequel fonder une culture et un sentiment républicains. Ces références, on les voulait « sans Dieu(x) », laïcisées. Là réside peut-être le point essentiel de l’entreprise colossale que représente l’élaboration du calendrier républicain : la laïcisation du rapport au temps. Le point de départ du temps qui passe (le 22 septembre 1792) n’est plus l’Incarnation (la naissance du Christ), mais la fondation de la République, non plus une action divine donc, mais l’action des hommes. C’est dire que le temps qui prend son élan à partir de cette date-rupture est un temps humain, un temps de l’homme et un temps pour l’homme. On ne saurait mieux rendre compte du basculement des rapports aux temps (les régimes d’historicité pour parler comme François Hartog) qui s’opère en cette fin de XVIIIe siècle dans les sociétés européennes. Point donc de « saints » ou de héros de jadis à célébrer dans le nouveau calendrier. Il faudra nommer les choses de manière neuve.
Le 20 septembre 1793, quand Gilbert Romme présente son rapport sur « l’ère républicaine », il propose dans le même temps toute une série d’appellations pour les nouveaux mois et les nouveaux jours du calendrier républicain. Romme avait puisé pour cela dans l’histoire immédiate de la Révolution. Il s’agissait, par le calendrier, de raconter cette histoire, celle de la Révolution, de la rappeler pour l’honorer autant que pour l’apprendre aux générations futures. Il avait aussi puisé dans les valeurs défendues par la République, ou ses emblèmes, ceux qui servaient de piliers au régime et qu’il fallait donc faire connaître, aimer et partager. Mai-Juin devenaient ainsi le mois du « Jeu de Paume » Juillet-août celui de la Bastille, septembre-octobre celui de la République, sans compter les mois de l’Unité, de la Fraternité, de la Liberté, l’Égalité… Idem pour les jours de la décade : jour du Bonnet rouge, de la Cocarde, de la Pique, du Faisceau…

Néanmoins, ce résumé de la Révolution, ce discours politique de la République sur elle-même, en 12 mois et séquences de 10 jours, ne réussit pas à convaincre les Conventionnels. Une nouvelle commission est donc chargée de réfléchir sur ce sujet. S’il y avait eu beaucoup de savants pour élaborer le nouveau mode de « découpe » annuelle de l’ère républicaine, ceux qui sont chargés de réfléchir aux noms de ces découpes sont cette fois essentiellement des hommes de lettres et des artistes. On y trouve par exemple le peintre Jacques-Louis David ou les poètes Chénier et Fabre d’Eglantine.
Fabre d’Églantine, en particulier, a joué un grand rôle dans le résultat final, qui a consisté à écarter la référence strictement révolutionnaire et à opter plutôt pour des références empruntées à la nature et au monde rural. Pourquoi la nature plutôt que la politique ? Après tout, cela peut paraître étonnant en 1793… L’une des raisons essentielles est que la nature était gage d’une plus grande universalité que les appellations étroitement liées à l’histoire révolutionnaire française. Il ne faut pas oublier, en effet, que, comme pour le système métrique, la Révolution ambitionnait l’universalisation de ses nouvelles mesures du temps. Toute une poétique du temps qui passe est alors imaginée, qui tente, par le mot, d’épouser le rythme des saisons. C’est d’évidence une réussite, au moins pour les noms des mois, car les termes proposés, inventés pour l’occasion, ont un véritable pouvoir d’évocation et nous sont, d’une manière ou d’une autre, demeurés familiers (même si on ne sait pas toujours où les situer dans l’année) : vendémiaire-brumaire-frimaire pour l’automne, pluviôse-nivôse-ventôse pour l’hiver ; germinal-floréal-prairial pour le printemps, messidor-thermidor-fructidor pour l’été. À chaque saison, on le voit, sa consonnance finale commune. Et avec chacun de ces noms, un imaginaire qui bat la campagne et se projette sans peine dans un climat, un paysage, une ambiance.
Concernant le nom des jours, plusieurs logiques ont été articulées. Le principe sera mathématique : primidi, duodi, tridi… jusqu’au « décadi », le 10e jour de la décade. On rattache ensuite chaque jour à une chose. Dans le cadre de la grande entreprise de régénération des individus et de la société que souhaitent mener les révolutionnaires, dans le cadre aussi de l’idéal volontiers agrarien des élites révolutionnaires, on opte pour un calendrier qui serait, en actes, pour tous les citoyens et futurs citoyens, une leçon d’économie rurale : à chaque jour de la décade une plante utile, si possible en rapport avec la saison (le 22 septembre, 1er jour du calendrier, est par exemple le jour du raisin). On intercale là-dedans, à chaque 5e jour de la décade, un animal domestique (la vache, l’oie…), et à chaque décadi un outil agricole (la charrue par exemple).
.
.
.
.
Les mois sont en effet un hommage appuyé à la culture agricole et rurale. Le calendrier est-il cependant accepté et appliqué dans les campagnes ?
.
.
.
.
Première chose : dans la mesure où il se veut être, par lui-même, une œuvre pédagogique, notamment dans le domaine agraire, dans la mesure aussi – et c’est bien sûr lié ! – où il se pense comme plus cohérent, plus rationnel que le vieux calendrier grégorien, le calendrier républicain est bien évidemment diffusé dans le pays par les révolutionnaires, et avec beaucoup d’énergie qui plus est. Les campagnes, au premier chef, sont visées. Gilbert Romme, le grand rapporteur de ce calendrier devant la Convention nationale, est d’ailleurs l’auteur d’un bien nommé Annuaire du cultivateur. Il s’agit d’un texte présentant la nouvelle mesure révolutionnaire du temps. L’impression de ce fascicule a été ordonnée par l’Assemblée nationale, à charge ensuite pour les autorités locales de le diffuser dans les écoles primaires, afin d’y servir à l’instruction des enfants – et on l’y trouve parfois, de fait, entre les mains des écoliers. Cependant, et c’est un deuxième point – ou un contre-point –, les résistances sont nombreuses dans le monde rural. Mais attention : il est important de bien les situer. Il a souvent été dit que les campagnes auraient refusé en bloc le calendrier révolutionnaire et que c’était là la marque évidente de l’atavisme du monde paysan, le symbole et la traduction tout à la fois de son rejet de la Révolution. Il faut préciser ce point de vue, qui ne rend pas vraiment compte de la réalité. D’abord, il y a ce que l’on observe du côté des administrations locales, ou encore des cabinets de notaires : à ce niveau-là, le nouveau calendrier est adopté rapidement, y compris dans le monde rural – dès décembre 1793-janvier 1794, en gros, et même un peu plus tôt dans les campagnes proches de Paris. En revanche, dans les usages quotidiens de la population, dans les conversations, on continue généralement de recourir aux anciens jours de la semaine, aux anciennes appellations des mois, au décompte traditionnel des années (1794, 1795…). Le jour de repos fixé par le nouveau calendrier (le décadi) ne parvient pas davantage à s’imposer, et le dimanche continue de lui être préféré. Pourtant, on ne peut pas dire que ces attitudes témoignent directement pour une hostilité à l’égard de l’œuvre révolutionnaire toute entière. Bien sûr, cela a pu être le cas, c’est évident. Mais il ne faut pas généraliser hâtivement. Plus d’une autorité républicaine (et j’entends par-là des administrations sous tous rapports non suspectes de complaisance à l’égard des idées contre-révolutionnaires) affirme, ainsi que l’a remarqué Danièle Pingué, que ces usages maintenus de l’ancien calendrier grégorien ne sont au fond pas si graves que cela, qu’il ne faut pas s’en inquiéter, que cela viendra… avec le temps. Mieux : certaines administrations municipales parmi celles qui témoignent en actes du républicanisme le plus prononcé, proposent de jouer des habitudes préservées de l’ancien calendrier pour mieux diffuser les principes révolutionnaires. Comment ? Et bien par exemple en célébrant l’anniversaire de la prise des Tuileries non pas le 10 août, comme il se devrait, mais le 9, afin de faire coïncider l’événement avec un dimanche et ainsi garantir une présence accrue de la population aux festivités. Ailleurs, des officiers municipaux accomplissent leurs fonctions d’explications des lois nouvelles – donc le rôle de médiation républicaine attendu d’eux – non pas les décadis, mais les dimanches pour de semblables question d’affluence. On le voit, une forme de pragmatisme a pu l’emporter ici ou là sur les logiques d’imposition brutale et de coercition : se plier aux réalités du terrain, à l’existant, pour populariser davantage les principes révolutionnaires.
.
.
.
.

.
.
.
.
« Le décadi ne s’accorde point avec la nature. Il n’y a ni hommes, ni animaux qui supportent neuf jours de travail consécutif. » Selon le député breton Lanjuinais. Le décadi a-t-il été une fausse bonne idée ?
.
.
.
.
Il est vrai qu’avec le système décadaire, on passe d’un jour de repos hebdomadaire (le dimanche, sans même compter que le lundi était aussi très souvent un jour chômé avant la Révolution) à un jour de repos sur dix (le décadi) ! À cela il faut encore ajouter la réduction drastique des jours fériés, assez nombreux dans l’ancien calendrier grégorien (ils y correspondaient aux grandes fêtes religieuses). Même si l’épuisement physique des corps laborieux n’est pas l’explication unique, ni même principale, de l’échec du décadi, force est de remarquer en tout cas que le repos décadaire ne prend pas, sinon ponctuellement. Pourtant, bien des autorités ont multiplié les efforts pour rendre les décadis désirables. C’est tout particulièrement le cas après le coup d’État du 18 Fructidor An V [opération politique menée en septembre 1797 par le Directoire, avec le soutien de l’armée, pour sauver la République contre les royalistes, devenus majoritaires au Conseil des Cinq-Cents et au Conseil des Anciens], alors que l’on déploie d’importants efforts pour raviver les institutions républicaines, au prix d’un combat acharné contre le royalisme et le « fanatisme » (c’est-à-dire la religion catholique et ses ministres du culte). Pourquoi pas, se demande-t-on alors, faire du décadi un jour non plus seulement de lecture des lois nouvelles – car cela peut être si austère et ennuyeux – mais également de réjouissances collectives, de joie, de vie. Par exemple, a relevé Mona Ozouf dans son travail sur les fêtes révolutionnaires, en y annonçant les événements heureux qui scandent l’existence de chacun : les mariages, les naissances, etc. D’autres républicains proposent que des guinguettes soient ouvertes, que l’on danse. Bref, que l’on s’amuse. Peine perdue. En l’an X (1801-1802), le Consulat refait du dimanche le jour officiel du repos des fonctionnaires. Cette décision étrange (le calendrier républicain demeure seul en vigueur, mais le repos est placé un dimanche, donc un jour se référant à l’ancienne mesure du temps, qui se superpose donc, légalement, à la scansion officielle de l’année…) marque la fin progressive du calendrier républicain. Il est définitivement abandonné au 1er janvier 1806.
.
.
.
.
Les mois sont féminins et d’apparence antique. Est-ce un hommage au passé lointain ?
.
.
.
.

Le calendrier républicain remobilise effectivement beaucoup de références antiques ! Les allégories féminines qui servent à l’illustrer dans les imprimés en sont, vous avez raison, un très bon exemple : généralement, les mois y prennent la forme de femmes en toges, représentées dans différentes postures, certaines offrant le sein aux Français. Ici, on le comprend, c’est la symbolique gréco-romaine qui joue à plein – elle est, de toute manière, omniprésente durant la Révolution. Mais cette filiation gréco-romaine ne s’arrête pas là. Les concepteurs du calendrier révolutionnaire avaient prévu l’ajout d’un jour intercalaire tous les 4 ans, c’est-à-dire un jour complémentaire de plus à la fin de l’année. Ces années-là (les années « sextiles »), il devait y en avoir 6 au lieu de 5. Or, ce que l’on sait peu, c’est que les révolutionnaires avaient prévu de consacrer ce 6e jour complémentaire à des « jeux olympiques », c’est-à-dire à des jeux sportifs en hommage à la Révolution. L’emprunt à l’antiquité grecque est ici manifeste : on mime, dans l’appellation, les anciens jeux panhelléniques d’Olympie, qui se déroulaient tous les 4 ans au sanctuaire de Zeus. Mais d’autres inspirations antiques s’ajoutent à celles-ci, sans être forcément grecques ou romaines. La découpe de l’année en 12 mois de 30 jours, complétés par 5 jours complémentaire reprend des manières de séquencer le temps déjà en vigueur dans l’Égypte ancienne. Gilbert Romme, dans son rapport sur « l’ère républicaine » du 20 septembre 1793, fait d’ailleurs explicitement référence aux Égyptiens.
.
.
.
.
Raisin, Faisan, Charriot, Pimprenelle, Loutre,… Les prénoms républicains ont-ils été acceptés ou imposés par l’administration révolutionnaire ?
.
.
.
.

Merci d’évoquer ces noms ! À les entendre me revient le mot de Mona Ozouf, qui parlait si joliment, au sujet de la dénomination des jours révolutionnaires, de véritable « herbier républicain ». Cela dit, pour répondre à votre question, il faut tout de même garder à l’esprit que dans la grande majorité des cas, les prénoms de l’ancien calendrier grégorien ont continué d’être donnés. Les noms « révolutionnaires » ou « républicains » demeurent l’exception – dans des proportions variables selon les régions et les lieux. Après le 9 Thermidor (c’est-à-dire la chute de Robespierre et de ses proches), le phénomène devient même encore plus rare. Mais un fois qu’on a dit cela, force est néanmoins de constater que des milliers d’enfants ont reçu, en 1792-1794, des prénoms républicains (des adultes parmi les plus militants s’en sont également donnés). Quelles sont leurs origines ? Beaucoup parmi eux renvoient aux héros républicains de la Rome antique (Mucius Scaevola, Gracchus, Brutus…), aux martyrs de la Révolution (Marat, Lepeletier), aux philosophes du panthéon révolutionnaire ou à leurs œuvres (Jean-Jacques, Émile…), à des valeurs révolutionnaires (Victoire, Constitution, Liberté, Égalité…). Dans de rares cas, des noms d’hommes politiques célèbres ont pu être donnés aux enfants (il y a eu quelques Robespierre, par exemple, mais très peu tout de même). Et puis, effectivement, il y a eu, parmi les sources d’inspiration des parents à l’heure de la naissance de leurs enfants, le calendrier républicain, qu’il s’agisse de donner à sa progéniture des noms de mois (bien des Floréal sont nés au printemps de l’an II) ou des noms de jours. Dans ce dernier cas, l’emprunt et la référence sont plus discrets, moins démonstratifs et, à ce titre peut-être plus durables – dès lors du moins qu’il s’agissait de doux noms de fleurs (pensons à Lilas, un jour célébré à la fin du mois de germinal), et non d’instrument agricoles (la fortune du prénom « Pioche » a été autrement plus éphémère !).
.
.
.
.
Y’a-t-il des tentatives d’installer le calendrier révolutionnaire sur les territoires occupés par les révolutionnaires français ?
.
.
.
.
Bien sûr ! Les départements annexés, dans les espaces allemands, italiens, hollandais, belges vont connaître une mise en application du calendrier républicain, tout simplement parce que ces territoires, en ce qu’ils font désormais partie intégrante de la République, voient se déployer une administration similaire à celle connue en France, par conséquent soumise aux mêmes contraintes réglementaires, notamment pour ce qui concerne la datation des actes publics.
.
.
.
.
22 Fructidor An XIII, le calendrier républicain est aboli. Sa fin est-elle plus politique que pratique ?
.
.
.
.
Sa fin est sans doute aussi politique que pratique. Elle survient à un moment où peu de monde le respectait dans la pratique et où le régime ressemblait de plus en plus à une monarchie, bien loin de l’idéal républicain. Mais dire cela ne suffit pas. Car aussi brève que son existence puisse nous sembler avoir été, on est bien obligé d’admettre que le calendrier républicain a eu, en réalité, une durée de vie autrement plus longue que d’autres symboles révolutionnaires. La pique, la cocarde, pour ne citer qu’eux, ont fait place nette bien avant lui. Mieux : il a survécu à la République, puisqu’il a continué d’être appliqué 6 années encore après le coup d’État du 18 Brumaire de Bonaparte, et même une année entière après le couronnement impérial de Napoléon en décembre 1804. Comment l’expliquer ? Le grand historien Bronisław Baczko a proposé à ce sujet une hypothèse séduisante : si le calendrier a perduré, malgré les critiques de plus en plus vives qui s’abattaient sur lui depuis Thermidor (ici ou là on s’est mis à le qualifier de « calendrier des tyrans »), c’est que sa suppression serait revenue à d’admettre la réversibilité du temps révolutionnaire, donc des événements révolutionnaires eux-mêmes. Comme si ce qui avait été fait pouvait être défait. Même si le régime voulu par les Thermidoriens (le Directoire) ne repose plus sur l’énergie politique populaire, la mobilisation constante de tous et de chacun dans les affaires de la Cité, mais sur la raison, la pondération, le suffrage censitaire, il n’en reste pas moins que la République – aussi modérée et bourgeoise soit-elle – ne pouvait admettre un tel principe de réversibilité sans que sa propre légitimité s’en trouve dangereusement affectée. L’idée d’une réversibilité du temps révolutionnaire était inenvisageable pour des personnes qui avaient voulu défaire un monde (la royauté et tout son univers de mythes et de symboles) et en bâtir un nouveau (la République, repeuplée de mythes et de symboles). Cela aurait été tout simplement admettre que le temps qu’on avait condamné, celui de la monarchie, pouvait revenir. Impossible !
.
.
.
.

.
.
.
.
En 1871 (An LXXIX), la Commune de Paris reprend le calendrier républicain. Cela ne durera que quelques jours mais cela peut-il s’expliquer par le souhait des Communards d’être les véritables héritiers de la Révolution française ?
.
.
.
.
Oui, il y a, pour partie, l’idée (déjà présente chez certains socialistes en 1848) de reprendre le combat là où il s’était arrêté en 1793. Mais les nostalgies à l’égard du calendrier républicains n’ont pas attendu l’aube de la 3e République pour se manifester. En fait, dès le moment de son abandon, en 1806, quelques voix se sont faites entendre pour exprimer des regrets. D’accord, disaient ceux-là, il valait peut-être mieux, à court terme, abandonner le calendrier républicain, compte tenu des refus populaires et de l’échec de son universalisation. Mais, tout de même, ajoutaient-ils, ce nouveau calendrier avait pour lui les arguments de la logique, de la raison. D’aucuns espérerons même que ses fondements, toute cette réflexion théorique, astronomique, mathématique engagée pour le bâtir en 1792-93, puisse servir à nouveau, plus tard, lorsque le moment sera enfin venu de mettre sur pied un calendrier moins défectueux que le calendrier grégorien, un peu trop court chaque année dans sa marche par rapport à la course de la terre autour du soleil, irrégulier dans les jours qui débutent les mois, etc.
Et, de fait, le calendrier sera, donc, éphémèrement repris par les Communards du printemps 1871, au même titre d’ailleurs que d’autres dénominations révolutionnaires (comité de salut public…). Mais osons remonter le temps jusqu’à nous. Il n’est pas rare, pour peu qu’une mobilisation dure suffisamment longtemps, que le calendrier révolutionnaire réapparaisse dans les luttes sociales et/ou politiques. Si vous cherchez des survivances actuelles, il n’est qu’à aller sur internet : vous y trouverez tout ce qu’il faut de convertisseurs « calendrier grégorien-républicain », de comptes Twitter ou Facebook pour vous donner la date du jour en calendrier révolutionnaire avec la plante, l’animal domestique ou l’outil agricole célébré ce jour-là, etc. Chaque année, on voit même la datation républicaine apparaître dans des copies d’étudiants – non sans humour ! Tout cela, cependant, aurait-il été de nature à satisfaire l’immense ambition que les révolutionnaires avaient placée dans leur refonte du temps ? On peut bien sûr en douter. Au fond, il s’agit surtout désormais, par là, d’exprimer une mémoire, un attachement, une forme de fidélité républicaine.